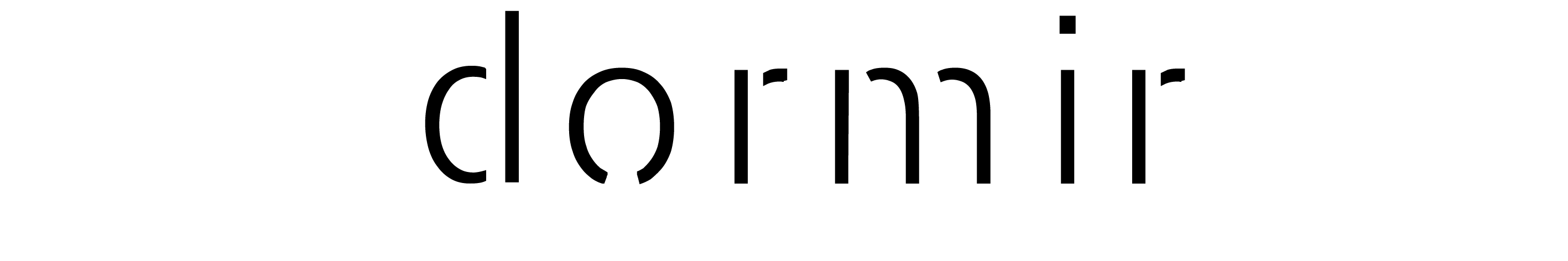
Il y a toujours un avion traître. Un avion fait de bric et de broc. Un avion aux sièges instables, aux hôtesses de l’air absentes, aux couloirs terriblement étroits, comme si l’engin avait été construit sur le modèle d’un train. Je pars avec ma promo, je reconnais les visages de W. et de WJ. Il y a d’autres personnes de ma connaissance, probablement du lycée. Nous sommes dans un avion sans toit, tout en étroitesse avec seulement 2 ou 4 sièges par rangée si mes souvenirs sont bons. L’avion ne décolle qu’à l’avant comme si l’arrière était trop lourd pour s’envoler, le pilote fait d’impressionnants loopings, des zigzags, des boucles. Les passagers arrière ne peuvent que constater l’étrange manège qui se déroule à l’avant tout en restant, eux, encore sur la piste de décollage. Nous arrivons finalement à destination, en Chine. Probablement à Pékin. Je me rends alors compte que je n’ai nulle part où loger. W. me dit qu’ils vont pour la plupart loger à Hangzhou car les tarifs y sont moins chers. Tout est en teintes ocre, gris et marron. Les bâtisses sont plutôt basses et semblent terreuses. Des fenêtres perforées et fumées, des chemins en terre battue, quelques placettes où s’alignent de nombreux restaurants opaques aux intérieurs mystérieux d’où émanent quelques silhouettes un peu austères. Il y a quelque chose d’européen, de médiéval, il n’y a pas de temples ou de sanctuaires. La végétation est parsemée, peut-être une odeur de fumée. Quelque chose d’inhabité, de caché et d’enfoui. W. et un homme inconnu, la cinquantaine, un peu bedonnant, m’accompagnent. Nous traversons un décor où tout le monde s’est éparpillé et je ne cesse de questionner mes compagnons sur le tarif et les disponibilités des fameuses pensions d’Hangzhou vers lesquelles nous nous dirigeons. Arrivés à destination nous pénétrons par une très petite porte. Une femme nous a ouvert, elle est assez âgée. Il y a un établi. Elle nous mène jusqu’à de très étroits escaliers qui descendent dans les profondeurs. Ils ne sont pas sans rappeler les escaliers de chez V. Avec leur odeur de vieille soupe et de poussière. À chaque palier une petite porte semble donner accès à un intérieur insalubre. Chaque pensionnaire est attendu, je n’ai toujours nulle part où aller. Après une longue descente nous atteignons le sous-sol le plus profond. La promo est là, nous sommes un peu entassés. Une petite pièce adjacente dans laquelle nous devons passer chacun notre tour. On y trouve une table en bois basse, des petits récipients en terre contenant de l’encens en poudre et quelques bâtons sur une autre table, plus basse encore. La vieille m’invite à me placer. Elle me tend une cigarette blanche déjà bien consumée, le tabac semble très pur. Elle m’invite à me pencher sur un des petits récipients et à tirer une latte sur la poudre pour y marquer une trace sombre. Elle me reprend la cigarette et m’indique les bâtons. Je ne sais pas si c’est sur son ordre ou de mon propre chef mais j’en saisis un entre mes dents. Je dois montrer mes gencives comme le ferait un chien. C’était un rituel nécessaire.
Je suis la narratrice plus ou moins omnisciente de l’histoire de deux meilleures amies. Toutes deux quarantenaires, elles se baladent dans une grande ville. Dans la scène à laquelle j’assiste, l’une d’entre elle, celle avec les cheveux courts, s’apprête à faire preuve d’audace, audace qu’elle estime décroissante au fil de l’âge. Les deux amies sont liées par un harnais au niveau de la taille, les harnais sont liés par une petite corde extensible qui permet qu’elles ne se perdent jamais de vue. Elles vont prendre le bus. Celle avec les cheveux plus longs est entrée en premier puis a attendu que le bus se mette en marche pour héler le chauffeur et lui demander de s’arrêter pour que son amie puisse monter. L’audace est là : laisser son amie dehors un moment, juste assez longtemps pour que le bus parte et qu’elle ait le courage de monter malgré le dérangement occasionné. Et puis, comment le chauffeur ne s’était-il pas rendu compte de la corde qui liait ces deux femmes ? Qui entravait les portes du bus et aurait traîné la femme aux cheveux courts le long de la route. Toujours est-il que la femme aux cheveux courts est montée. Et en montant elle a cité un adage. Et c’est l’adage qui est important : « Au premier cycle les abeilles butinent allègrement le sureau Au deuxième cycle (je me rappelle mal) Au troisième cycle les abeilles waxèrent (néologisme et passé simple) à blanc dans de la vase » En tant que narratrice omnisciente je sais décoder cet adage. Le premier cycle correspond à l’enfance et à l’adolescence, le deuxième à l’âge adulte et le troisième à la vieillesse. Si on ne sait pas jouir de sa vieillesse et être audacieux alors on waxe (cela signifie que l’on produit de la cire inutilement) dans une flaque de boue. Comme un essaim d’abeilles agitant leurs ailes dans une flaque, produire stérilement. La phrase créé une image. Une image qui me bouleverse. Plus tard je ne suis plus narratrice, j’entre dans une librairie où un album est mis en valeur. Sur la couverture est écrit WOMAN on y voit le portrait d’une femme aux cheveux courts. C’est l’histoire que je viens de raconter.